Un millénaire et demi
 Un millénaire et demi, un tel anniversaire n’arrive pas tous les jours. Et pourtant on vient de célébrer les mille cinq cents ans de la mort de Clovis dans l’indifférence quasi générale, hormis à Soissons où Clovis est une star, bien entendu.
Un millénaire et demi, un tel anniversaire n’arrive pas tous les jours. Et pourtant on vient de célébrer les mille cinq cents ans de la mort de Clovis dans l’indifférence quasi générale, hormis à Soissons où Clovis est une star, bien entendu.
L’affaire remonte, donc, au 27 novembre 511. Après une vie trépidante et un règne mené au grand galop, le roi des Francs décède à 45 ou 46 ans. Il est inhumé dans une église qu’il a fait construire avec son épouse la pieuse Clotilde, l’église des Saints-Apôtres. Elle ne tardera pas à devenir l’abbatiale Sainte-Geneviève, dans l’actuel quartier latin. Geneviève est contemporaine de Clovis : la patronne de Paris, si déterminée face à Attila et ses Huns, meurt en 512.
Il s’en passe des choses en quinze siècles. L’abbatiale a disparu, de l’abbaye il reste une tour dénommée la tour Clovis, juste derrière le Panthéon. C’est un hommage posthume : la tour elle-même ne date que du 12e siècle.
Cette tour Clovis règne aujourd’hui sur le lycée Henri IV, et c’est un privilège d’être autorisé à y monter. Le lycée lui-même s’élève rue Clovis, c’est bien le moins.
Si la mort de Clovis n’émeut guère, en revanche son baptême a marqué les esprits. Son mille cinq centième anniversaire avait lieu à la Noël 1996.
Et oui, c’était hier ou presque. Un rapide calcul rappelle que pour une fois, la date du baptême ne correspond pas à celle de la naissance. Clovis, païen, s’est converti au catholicisme à l’âge adulte.
Une verrière de la collégiale de Poissy rapproche dans ses trois lancettes le baptême de Clovis, celui du Christ et celui de Saint-Louis. A gauche, on voit le roi franc, les pieds dans une piscine, en train d’obéir à l’injonction de saint Rémi, à Reims : « Courbe la tête, fier Sicambre ! »
Au milieu, c’est Jésus baptisé par saint Jean-Baptiste dans le Jourdain.
A droite, bébé Louis IX est porté sur les fonts baptismaux en l’église de Poissy.
Un tel rapprochement donne à méditer. A première vue, il me choque. Si je peux comprendre la présence de Louis IX, canonisé, aux côtés de Jésus – et déjà avec réticence quand on pense à son intolérance à l’égard des juifs – que Clovis, ce roi brutal, sanguinaire, opportuniste soit élevé à cette dignité, voilà qui surprend !
C’est que Clovis, par son baptême, a été le premier roi des Francs à appuyer le pouvoir monarchique sur le pouvoir ecclésiastique. Saint-Louis s’inscrit dans cet héritage. Son prénom même, Louis, est dérivé de Clovis.
Monet à Poissy
 Claude Monet a habité la ville de Poissy, dans les Yvelines (on disait alors la Seine-et-Oise) de décembre 1881, date où il quitte Vétheuil, à avril 1883, où il emménage à Giverny.
Claude Monet a habité la ville de Poissy, dans les Yvelines (on disait alors la Seine-et-Oise) de décembre 1881, date où il quitte Vétheuil, à avril 1883, où il emménage à Giverny.
Poissy est situé sur la rive gauche de la Seine à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Paris. La ville est célèbre pour avoir vu en 1214 la naissance et le baptême du roi Louis IX, autrement dit Saint-Louis. Aujourd’hui, le bon roi est toujours omniprésent dans la cité où son nom est utilisé par toutes sortes de commerces.
La maison que Monet loue à Poissy pour y vivre avec ses deux fils, sa compagne Alice Hoschedé et les six enfants de celle-ci s’élève au bord du fleuve, face à une île. Elle s’appelle inévitablement la villa Saint-Louis.
C’est une demeure bourgeoise typique de l’époque, presque aussi large que longue, couverte d’un toit d’ardoises percé de lucarnes.
Elle porte une plaque discrète sur laquelle on peut lire : « Je ne veux que peindre la beauté de l’air. Ici vécut le peintre Claude Monet de décembre 1881 à avril 1883. Hommage de la Ville de Poissy. »
Quand on voit cette belle et vaste bâtisse admirablement située au bord de l’eau, sur une placette à deux pas du centre ville et de la gare, on se dit que Monet a bien choisi sa maison. Lui qui aimait tant l’eau et la nature, il avait tout pour être heureux ici. Les motifs ne devaient pas manquer, la Seine et l’île en face, le pont, la belle église et ses deux clochers romans… On imagine les quatre bateaux de la famille amarrés en bas du talus, prêts à servir pour partir peindre.
Mais en fait, Monet va très peu produire à Poissy. Quand on a des tourments, aucun séjour ne saurait être agréable. Malgré le charme du lieu, Monet passe le moins de temps possible dans la maison, il fuit « cet horrible Poissy » où il se sent de trop.
La situation est devenue très ambiguë depuis qu’Alice et lui ont quitté Vétheuil. Vivre sous le même toit est très compromettant. S’il est maintenant veuf, elle est toujours la femme d’Ernest Hoschedé, et tiraillée entre son devoir d’épouse et ce que lui dicte son coeur. Monet, qui vit dans une douloureuse incertitude, passe donc beaucoup de temps à peindre sur la côte d’Albâtre, à Pourville ou à Etretat.
Et puis, bientôt, il faut quitter Poissy. Fidèle à son habitude, la famille y vit au-dessus de ses moyens. Monet est incapable de payer le loyer de cette maison cossue, et ce sera encore son marchand Paul Durand-Ruel qui devra le secourir pour lui permettre de déménager à Giverny.
Vue de Vétheuil
 A vingt kilomètres de Giverny en direction de Paris, voici le village de Vétheuil, vu au mois de mai depuis le hameau de Lavacourt sur la rive gauche de la Seine.
A vingt kilomètres de Giverny en direction de Paris, voici le village de Vétheuil, vu au mois de mai depuis le hameau de Lavacourt sur la rive gauche de la Seine.
Monet s’y retire en 1878, dans une petite maison en location qu’il partage avec la famille Hoschedé.
Quand Monet jette son dévolu sur le village de Vétheuil, c’est l’été, il cherche de jolis motifs à peindre et un endroit où vivre à bon marché. Les trois années passées à Vétheuil, si elles sont difficiles sur le plan financier et affectif, vont être très productives. L’église, le fleuve, les îles, Lavacourt, les champs de coquelicots offrent à Monet une multitude de motifs, puis se seront les glaçons sur la Seine gelée.
On aperçoit sur la photo le toit de la maison de Monet, c’est la deuxième en partant de la gauche. Elle se trouve au pied du manoir à tourelle qui appartenait à la propriétaire de la maison, et qui fut habité plus tard par la peintre américaine Joan Mitchell.
Plusieurs autres artistes ont aussi séjourné à Vétheuil, sans pour autant que le village ne devienne une colonie.
Entre la route et la Seine, s’étendait le jardin en pente où Monet cultivait des tournesols, et qu’il a peint à plusieurs reprises. De là il n’avait plus que quelques pas à faire pour retrouver son bateau amarré au ponton.
Angelot
 C’est dans l’église de Giverny que l’on peut admirer cet adorable angelot accroché dans les airs au-dessus des fidèles. Le visage grave, il semble avoir tenu quelque chose dans ses mains, peut-être le manteau de la Vierge dans une Assomption ?
C’est dans l’église de Giverny que l’on peut admirer cet adorable angelot accroché dans les airs au-dessus des fidèles. Le visage grave, il semble avoir tenu quelque chose dans ses mains, peut-être le manteau de la Vierge dans une Assomption ?
La Renaissance et la période baroque ont raffolé de ces petits anges potelés tous plus craquants les uns que les autres.
Leur mode, arrivée d’Italie, puise dans la mythologie grecque et romaine. Ce sont d’abord des Cupidon, avec flèches et carquois pour viser les mortels et les rendre follement amoureux.
Quand on redécouvre ces angelots malicieux au 15e siècle, ils plaisent tant qu’on en met partout. Ils quittent les scènes mythologiques pour s’inviter dans l’art profane mais aussi sacré. Figurés sous forme de bébés joufflus de sexe masculin, les bambins ailés ou non prennent le nom de putti et dansent, jouent de la musique, ou se livrent sous le pinceau de Nicolas Poussin à d’étranges bacchanales.
Les petits putti sont si mignons qu’ils ne tardent pas à entrer en religion. Cette fois, ce sont bel et bien des anges, parfois nommés à tort des chérubins (aux dires des personnes averties, les chérubins sont plus grands et ressemblent à des hommes éternellement jeunes).
On apprend tout sur les anges dans le Traité d’Iconographie Chrétienne de Mgr Xavier Barbier de Montault. Le paragraphe consacré à la représentation angélique dans l’art est très éclairant.
L’ange est soit figuré en entier, mais souvent sans pieds, ou les pieds cachés, ce qui le « dégage de la terre ». Soit il est peint ou sculpté en partie seulement, sans jambes et même sans buste.
De la sorte il est de moins en moins matériel et réduit à l’élément indispensable pour représenter une créature vivante et intelligente.
L’église de Giverny présente de telles têtes d’anges dans la voûte de son choeur en cul de four. Aux dires des artisans qui ont procédé à leur restauration l’année dernière, ces « anges chauves-souris » ne sont pas des merveilles, mais auraient pu être peints par le bedeau au 19e siècle… Peut-être un effet de la fièvre picturale qui régnait alors à Giverny ? L’église étant classée, les angelots ont tout de même été ressortis de l’oubli où les avait plongés une couche de badigeon. Même si ce ne sont pas des oeuvres d’art, ils émeuvent par leur naïveté et la foi de la personne inconnue qui les a peints.
Ceratostigma
 Si vous êtes un peu fleur bleue, vous avez sûrement remarqué cette vivace couvre-sol qui fleurit à la fin de l’été. Elle affectionne les expositions ensoleillées, celles où les chats aiment paresser en fin d’après-midi dans la douceur de septembre.
Si vous êtes un peu fleur bleue, vous avez sûrement remarqué cette vivace couvre-sol qui fleurit à la fin de l’été. Elle affectionne les expositions ensoleillées, celles où les chats aiment paresser en fin d’après-midi dans la douceur de septembre.
Comme son nom de baptême est un peu compliqué, ceratostigma, on lui en fait porter un autre : faux-plumbago. Et ce n’est pas si faux que ça, puisque le ceratostigma appartient à la même famille, et partage avec la liane méditerranéenne la joliesse de ses fleurettes azurées, qu’on dirait découpées à l’emporte-pièce tant leur patron est sobre, sans froufrous.
Les fleurs sont piquées par petits bouquets dans un feuillage dense. Contrairement aux couvre-sol printaniers qui forment des coussins de couleur, chez le faux-plumbago les feuilles sont bien présentes, vertes d’abord, puis de plus en plus rouges, jusqu’à former une masse pourpre parsemée de bleu du plus bel effet.
Le plumbago, vrai ou faux, a un je-ne-sais-quoi de familier, un air d’avoir déjà été croisé quelque part. Un indice : cela concerne la santé.
Vous avez trouvé ? Non, le plumbago ne soigne pas les lumbagos, dommage ! Mais on lui attribue des vertus contre le saturnisme (plumbago viendrait de plomb). Il paraît qu’il soulage aussi les mots de dents, d’où un surnom supplémentaire, dentelaire du Cap.
Surtout, le plumbago connaît une célébrité thérapeutique nouvelle grâce à l’engouement pour les élixirs floraux de Bach. Il est réputé aider les personnes indécises et découragées. Vendu sous l’appellation Cerato / Plumbago, il me semble que l’élixir est produit à partir de notre petite vivace herbacée et non de son altière cousine sarmenteuse, bien que ce soit cette dernière qui illustre la fleur dans les différents sites sur les fleurs de Bach. Je l’avoue, j’ai bachoté un peu, sans arriver à une certitude. Alors Cerato ou Plumbago ? N’est pas bachelière qui veut !
Cathédrale de Coutances
 Parmi toutes les cathédrales normandes, Rouen est la plus grande, Bayeux peut-être la plus riche, et, sans vouloir froisser personne, Coutances l’une des plus belles, pour sa pureté et sa luminosité.
Parmi toutes les cathédrales normandes, Rouen est la plus grande, Bayeux peut-être la plus riche, et, sans vouloir froisser personne, Coutances l’une des plus belles, pour sa pureté et sa luminosité.
La cathédrale de Coutances telle que nous la voyons date du 13e siècle, elle a donc été bâtie en style gothique rayonnant. L’édifice roman qui préexistait a été englobé dans la maçonnerie, une pratique qu’on retrouve ailleurs, par exemple au Mont Saint-Michel ou, plus près de Giverny, à Vétheuil.
On n’aura pas trop de regrets, car si l’église romane était peut-être fort belle, la cathédrale gothique est une pure merveille.
Quand le remodelage de Coutances commence, c’est le début du 13e siècle, et depuis que Philippe-Auguste a annexé la Normandie après la prise de Château-Gaillard en 1204, la région traverse une période de paix et de prospérité qui va durer jusqu’à la guerre de Cent ans, cent cinquante ans plus tard. Partout, on construit, on agrandit, on remanie les églises.
La ville de Coutances se trouve dans le sud du Cotentin, la presqu’île qui s’avance dans la Manche comme un bras désignant l’Angleterre. Le style gothique s’impose dans toute la France, mais on décèle des variations locales. Celles qui caractérisent le gothique normand sont réunies à Coutances.
La magnifique tour lanterne a fait la réputation de l’édifice. Sa voûte culmine à plus de 40 mètres du sol. A mesure que l’on s’élève, on passe du plan carré des quatre piliers qui la soutiennent au cercle, au sommet de la voûte : le carré symbolise la Terre, le cercle représente le Ciel. Entre les deux, un octogone, image de la Résurrection. Les baies de la tour lanterne, qui créent un puits de lumière à la croisée du transept, s’alignent sur cet octogone. Leur forme longiligne évoque celle de cierges sur les candélabres en forme de roue qui éclairaient autrefois les églises.
Avec l’élévation à trois niveaux, les coursières sont une autre caractéristique du gothique normand. Voyez-vous les fenêtres hautes de la nef et du transept ? La coursière est l’étroit passage bordé par un balcon qui permet de marcher devant les fenêtres hautes. Les chanoines pouvaient y accéder pour certaines célébrations.
Normande encore (la liste n’est pas exhaustive), la multiplication des moulures des piliers. L’idée est de renforcer la verticalité, support à l’élévation spirituelle : de nombreuses lignes verticales soulignées par le jeu de l’ombre et de la lumière comme par un trait de crayon noir accentuent l’impression de mouvement ascensionnel.
Deuxième atelier
 A quelques pas de sa maison de Giverny, Claude Monet a fait construire un vaste atelier en 1899, une fois l’aisance venue.
A quelques pas de sa maison de Giverny, Claude Monet a fait construire un vaste atelier en 1899, une fois l’aisance venue.
Le premier atelier se trouvait dans la maison principale, sous sa chambre à coucher. Ancienne grange, mal éclairé et trop petit, il n’était pas très fonctionnel. Il est devenu le salon-fumoir de Monet, décoré des oeuvres que le peintre se réservait pour lui-même.
En faisant bâtir un second atelier, Monet souhaite un espace assez grand pour répondre à ses besoins. Le beau volume est la première chose qui frappe en entrant dans la pièce. Et l’immense verrière, qui donne tout son charme au lieu.
Depuis la rue, le vitrage recouvert de vigne vierge se devine plus qu’il ne se voit. De l’intérieur, le végétal forme un rideau. La pièce reste néanmoins baignée de lumière. Elle bénéficie d’une double exposition, avec des baies côté sud, vers le jardin.
Toute cette luminosité plaît beaucoup aux ficus qui atteignent des tailles imposantes et donnent aujourd’hui à l’atelier un air de jardin d’hiver.
L’escalier conduit à une mezzanine sur laquelle s’ouvre la porte d’une chambre à coucher. C’était celle du premier conservateur de Giverny, Gérald van der Kemp. Florence, son épouse, avait sa suite derrière la bibliothèque du peintre, conformément à l’usage en vigueur quelques décennies plus tôt chez les Monet de faire chambre à part.

Du temps du peintre, le deuxième atelier regorgeait de toiles, un peu comme le premier. C’est là que Monet conservait Femmes au jardin et les parties rescapées du Déjeuner sur l’herbe, trop grands sans doute pour s’harmoniser avec les autres oeuvres dans le salon-atelier.
Le duc de Trévise accompagné du photographe Pierre Choumoff a rendu visite au patriarche de Giverny en 1924. De cette entrevue datent les rares clichés publiés de ce deuxième atelier.
Difficile de reconnaître sur ces photos l’agencement d’aujourd’hui. Escalier, mezzanine, bibliothèque y sont invisibles.
Les van der Kemp ont arrangé la maison à leur goût, pour y demeurer une partie de l’année. Ils n’avaient pas l’intention de l’ouvrir au public, et à l’heure actuelle, ce n’est pas d’actualité non plus. L’atelier sert seulement de salle de réunion ou de réception.
Lambrequin
 Le lambrequin a fait fureur au 19e siècle, avant de passer de mode. Ces frises de bois découpé longent les extrémités des toits, les bords de lucarnes en suivant habilement leur pente pour donner l’illusion d’une frange qui pend.
Le lambrequin a fait fureur au 19e siècle, avant de passer de mode. Ces frises de bois découpé longent les extrémités des toits, les bords de lucarnes en suivant habilement leur pente pour donner l’illusion d’une frange qui pend.
Sur la Côte fleurie, les lambrequins sont caractéristiques des chalets.
Dans les années 1860-70, les plages du Calvados se sont transformées en stations balnéaires. Tout un style architectural était à inventer pour un mode de vie nouveau, la villégiature de bord de mer, et pour une population nouvelle, de riches bourgeois qui avaient l’aisance modeste.
Les architectes de l’époque se sont montrés très inventifs. Une des solutions trouvées, c’est le chalet.
Aujourd’hui où la zone de diffusion du chalet se réduit aux abords des pistes de ski, on a du mal à l’imaginer en bord de mer. D’ailleurs, les chalets de Villers-sur-Mer, Cabourg, Houlgate ou Deauville n’ont pas grand chose à voir avec leur « modèle » alpestre.
Comme toutes les villas construites à cette époque, ils revendiquent une source d’inspiration, sans en proposer un pastiche. Des chalets de montagne, les architectes ont retenu la situation isolée – et les leurs seront entourés de jardins -, les larges toits qui débordent de la façade, les balcons, et les bois découpés.
Pour Gilles Plum, spécialiste des Villas balnéaires du second Empire (éditions Cahier du Temps), ces choix déterminent un nouvel espace architectural :
Le débordement des toits délimite un espace extérieur protégé qui crée un intermédiaire entre l’extérieur et l’intérieur de la maison. Cet espace est occupé et enrichi par les projections vers le dehors de la surface habitable que sont les balcons et les bow-windows.
C’est l’esprit du temps, un nouveau rapport entre l’homme et la nature. Pas tout à fait dedans, pas tout à fait dehors, l’estivant a le choix de jouir du paysage dans cet entre-deux qui le protège des éléments.
Sur le plan plastique, les bois découpés marquent la limite de cet espace intermédiaire, « en descendant sous forme de lambrequins depuis l’extrémité du toit ou en montant sous forme de garde-corps depuis les balcons ». L’effet en est très subtil, car ils créent « un second niveau de façade très léger qui ombre ou cache en partie celle en maçonnerie ».
Quand le soleil brille sur les lambrequins, il projette leur ombre à trous-trous sur les murs. L’auteur y voit un lien avec l’intérêt des impressionnistes pour le jeu de l’ombre et la lumière à travers les arbres. L’air du temps, encore.
Monts et Monet
 Qu’a pu ressentir Claude Monet en découvrant la Suisse à 70 ans passés ? Pour ce normand habitué à la douceur des paysages du val de Seine, qui aimait la confrontation avec les falaises du pays de Caux, le face-à-face avec la montagne a dû être une révélation. Plus encore qu’ailleurs l’éclairage y évolue au fil des heures. La course du soleil illumine des pans entiers de la montagne, ou au contraire les plonge dans l’ombre, une ombre vaporeuse et bleue qui silhouette les cimes.
Qu’a pu ressentir Claude Monet en découvrant la Suisse à 70 ans passés ? Pour ce normand habitué à la douceur des paysages du val de Seine, qui aimait la confrontation avec les falaises du pays de Caux, le face-à-face avec la montagne a dû être une révélation. Plus encore qu’ailleurs l’éclairage y évolue au fil des heures. La course du soleil illumine des pans entiers de la montagne, ou au contraire les plonge dans l’ombre, une ombre vaporeuse et bleue qui silhouette les cimes.
Monet aurait aimé Martigny. Son nom s’y étale partout pour quelques jours encore, au travers des rues, sur les affiches, et dans les vitrines de tous les commerçants, jusque sous le grand M vert d’une chaîne de restauration rapide.
J’admire la détermination avec laquelle l’équipe de la Fondation Pierre Gianadda s’emploie à faire connaître son musée, créé en 1978 dans cette petite ville de 15 000 habitants perdue au bout d’une vallée, sur la route des cols parmi les plus vertigineux des Alpes. C’était une gageure d’en faire un grand rendez-vous culturel. A force d’énergie et de volonté, les collections se sont enrichies, les expositions sont toujours plus prestigieuses, les concerts aussi. Monts et merveilles.
Comment attirer le public ? La question s’est posée, identique, à l’ouverture des jardins de Monet en 1980. Ce n’est pas facile de lancer un site culturel. Les réponses se lisent dans l’après-coup. Bien sûr, il faut communiquer, beaucoup. Mais pas seulement. L’important est d’avoir quelque chose à offrir.
A Martigny, l’option choisie a été de proposer des axes différents : non seulement les expos de peintures et de photos, mais aussi des collections permanentes de sculptures du 20e siècle, des vestiges gallo-romains, des voitures anciennes, des maquettes d’engins de Léonard de Vinci… C’est la technique des cadeaux bonus des bonimenteurs, à la fin on ne peut pas résister.
A Giverny, en 1980, on avait un jardin encore jeune, une maison refaite à neuf, mais pas de tableaux. On comprend que le directeur Gérald van der Kemp ait décidé de montrer toutes les estampes japonaises dont il disposait, histoire d’ajouter des attraits à la mariée.
Aujourd’hui où les visiteurs affluent, on a moins besoin des gravures sur les murs de la maison de Giverny. Quatre douzaines des estampes collectionnées par le peintre sont présentées à Martigny, dans le cadre de l’exposition Monet.
Curieusement, la différence de style entre les toiles impressionnistes et les gravures japonaises est si radicale que même le visiteur averti n’arrive pas à faire le lien. L’idée que les deux expos n’ont rien à voir s’impose, par contagion des autres sections.
Le jardin de Pierre Corneille
 De la maison de ville de Pierre Corneille, en plein coeur de Rouen, à sa maison des champs de Petit-Couronne, il y a huit kilomètres, une distance qui se parcourt en dix minutes quand la circulation est fluide.
De la maison de ville de Pierre Corneille, en plein coeur de Rouen, à sa maison des champs de Petit-Couronne, il y a huit kilomètres, une distance qui se parcourt en dix minutes quand la circulation est fluide.
Combien de temps mettait Corneille à rejoindre sa campagne, et dans quel équipage s’y rendait-il, avec sa nuée d’enfants ? C’était sans doute une expédition, qu’on n’entreprenait pas tous les week-ends.
Sur place, dans cette maison aux dimensions modestes – deux pièces en bas, trois pièces en haut – l’imagination hésite encore. Où dormait tout ce monde ? Thomas, l’inséparable petit frère de dix-neuf ans plus jeune que Pierre, était-il aussi de la partie, comme le suggère une gravure accrochée au mur ?
La maison récemment restaurée a un air si pimpant qu’il est difficile de s’imaginer quels sont les éléments d’origine. Les meubles, d’époque, ont tous été rapportés. Mais même si l’authenticité est absente, l’esprit des lieux est bien là et vaut la peine d’être ressenti.
Dans le jardin, plus petit qu’autrefois, beaucoup de fleurs et de légumes résistent encore vaillamment à la fraîcheur de l’automne. Il n’a pas gelé ici. L’orange des capucines vibre. Sur le gazon, les pétales de roses se mêlent aux feuilles rougies du cerisier.
Entièrement recréé il y a une quinzaine d’années, le potager obéit au même principe de restitution que l’ameublement de la maison. Seuls les végétaux qui étaient déjà cultivés au 17e siècle y ont droit de cité. Exit les tomates, on récolte ici des cives, des panais, du poireau perpétuel et des carottes blanches, du chou, des herbes aromatiques, des pommes, des cerises, des noix…
Les plates-bandes impeccables s’alignent à côté du four à pain, et ce voisinage entre les futurs légumes du potage et les miches odorantes qui pourraient sortir du four met l’eau à la bouche.
La maison des champs de Pierre Corneille est une enclave de vie rurale calme et lente, une petite bulle de nature et de 17e siècle tout à la fois.
Corneille devait y puiser l’harmonie de ses vers. C’est un endroit où plonger ses racines.
Racine… j’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ?
Monet à l’heure suisse
 Claude Monet, Nymphéas, vers 1914, 135x145cm, collection particulière
Claude Monet, Nymphéas, vers 1914, 135x145cm, collection particulière
L’exposition Monet de la Fondation Gianadda à Martigny, qu’on peut encore se dépêcher d’aller voir d’ici le 20 novembre 2011, se compose à la fois d’oeuvres venues de France et de toiles issues des collections suisses, publiques et privées.
Les premières, des tableaux du musée Marmottan et des estampes japonaises de Giverny, ont été prêtées par l’Institut de France. C’est un prêt entre amis : Léonard Gianadda est lui-même membre de l’Institut.
Les secondes permettent de se faire une idée de l’intérêt des collectionneurs suisses pour Claude Monet.
C’est un art délicat que de composer une collection de tableaux. Affaire de goût personnel, affaires tout court.
Faut-il parier sur l’avant-garde ? Miser sur les valeurs montantes ? Préférer les peintres reconnus ? Être moteur de l’histoire, ou attendre que le temps ait trié le bon grain de l’ivraie ?
Le temps, qui fait et défait les cotes, est une donnée cruciale. Et le temps, en Suisse, on connaît. On sait le mesurer, on sait aussi le prendre.
Lukas Gloor, qui dirige la Fondation Bührle à Zurich, a contribué au catalogue de l’expo de Martigny, dans lequel il livre une passionnante analyse des fluctuations de la réception suisse de Monet.
Alors que le chef de file de l’impressionnisme séduit dès 1886 aux États-Unis, il va mettre beaucoup plus de temps à franchir les Alpes que l’Atlantique.
Les raisons en sont multiples. A la fin du 19e, les villes suisses « ne disposaient pas du rayonnement suffisant pour susciter la collaboration de partenaires de l’étranger. » Ce n’est qu’à partir de 1908 qu’apparaissent les premières collections privées faisant une large place à l’impressionnisme français. Mais les oeuvres de Monet n’y sont « que modestement présentes. » Trop chères maintenant.
Et puis, il y a autre chose. Les Suisses doutent que Monet soit le bon cheval. Un influent critique d’art allemand le considère comme un artiste de second plan. Pour Meier-Graefe, il n’y a que Manet, Cézanne, Degas et Renoir qui vaillent, les quatre piliers de la peinture moderne. Les premières années de Monet, passe encore, il y voit une certaine poésie vivante, mais après, tout est à jeter, surtout les séries bâties sur une stupide théorie chromatique.
Monet rhabillé pour l’hiver, il faut une certaine indépendance d’esprit aux acheteurs pour l’intégrer tout de même, timidement, dans leurs collections.
Tout va changer à partir de 1949. Cette année-là, la Kunsthalle de Bâle présente une exposition de paysages impressionnistes français. On y voit pour la première fois les immenses panneaux surnuméraires des Nymphéas, ceux que Claude Monet n’a pas retenu pour l’Orangerie. Ils arrivent tout droit de Giverny, prêtés par Michel Monet.
Deux ans plus tard, le collectionneur Emil Bührle se rend à Giverny, et il achète au fils du peintre deux panneaux de six mètres du cycle des Nymphéas.
Michel Monet, qui désespérait de les vendre, cède ces douze mètres linéaires pour environ 40 000 euros. Considérés comme de simples « décorations », ces panneaux sont alors moins chers que les tableaux de chevalet.
Bührle est en avance sur son temps. En 1955, les grands Nymphéas entrent au Moma de New-York. Le Monet tardif est promu précurseur de l’expressionnisme abstrait. Ce nouveau positionnement dans l’histoire de l’art suscite un nouvel intérêt pour ses dernières oeuvres. Cette fois, les collectionneurs suisses sont bien là.
Le cartel de Monet
 Cette jolie pendule posée sur une console se trouve dans la chambre à coucher de Monet à Giverny.
Cette jolie pendule posée sur une console se trouve dans la chambre à coucher de Monet à Giverny.
Placée comme elle est dans l’encoignure du mur à côté de la fenêtre, derrière la porte qui mène au cabinet de toilette, il faut être un visiteur attentif pour la remarquer.
Son raffinement surprend, dans cette chambre au lit et à l’armoire tout simples.
Je ne me souviens pas d’avoir lu quelque chose sur cette pendule, elle gardera donc son mystère. Si un horloger ou un antiquaire passe sur cette page, j’aimerais bien avoir son avis.
A première vue, il me semble que c’est un cartel de style Louis XV, que Monet pourrait s’être acheté à la fin du 19e siècle, à moins qu’il ne l’ait reçu en cadeau. Le cadran, orné de deux très belles aiguilles, ne porte pas de signature apparente.
Je ne crois pas non plus avoir jamais entendu sonner ce cartel, j’ignore s’il fonctionne, à l’inverse de l’horloge du salon bleu qui rythme les heures et les demies de son timbre aigu tout simple.
On passait beaucoup de temps autrefois à remonter les montres, les pendules et les horloges. On a oublié cette servitude aujourd’hui.
Mais demain, il faudra faire le tour de tout ce qui donne l’heure dans la maison pour remonter le temps de soixante minutes, sauf bien sûr les appareils qui sont assez malins pour se mettre à l’heure d’hiver tout seuls.
Derniers jours de l’expo Clark
 Vite ! Il ne reste plus que jusqu’à lundi soir pour voir l’exposition Clark au musée des impressionnismes Giverny. Le dernier jour est le 31 octobre 2011.
Vite ! Il ne reste plus que jusqu’à lundi soir pour voir l’exposition Clark au musée des impressionnismes Giverny. Le dernier jour est le 31 octobre 2011.
Après, tous ces sublimes Renoir, ces somptueux Monet (l’Aiguille d’Etretat, les Oies dans le ruisseau…) ces fascinants Corot vont reprendre la route, non pas tout de suite vers le Francine and Sterling Clark Institute de Williamstown, au Massachussetts, mais vers Barcelone dans un premier temps.
Jamais une expo n’aura fait à ce point l’unanimité à Giverny, comblé autant les visiteurs, qui ressortent éblouis par tant de toiles exquises.
Quel rassemblement de premier ordre ! Un exemple : l’oeuvre de Renoir que l’on aperçoit à gauche sur la photo, la jeune fille endormie avec un chat sur les genoux, a fait partie de la collection personnelle de Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes, qui l’avait accrochée dans son grand salon. C’est un signe qui ne trompe pas.
Bref, vous ne pouvez pas rater cette expo. Dépêchez-vous !
Octobre à Giverny
 Fermeture annuelle des jardins de Monet à Giverny : 1er novembre 2011 à 18h
Fermeture annuelle des jardins de Monet à Giverny : 1er novembre 2011 à 18h
Ça y est ! L’automne s’annonce à Giverny. Chaque année j’attends avec impatience la deuxième quinzaine d’octobre, la cerise rouge sur le gâteau de la saison. Le grand embrasement des arbres. Et les reflets chauds dans l’étang de Monet.
Du côté du clos normand, le jardin de fleurs est sur le déclin. Il a fait -2°C cette nuit, il ne faut pas s’attendre aux merveilles qui rayonnaient partout début octobre, les dahlias somptueux, la rivière de capucines, le festival de sauges, de soleils et d’asters. Mais tandis qu’annuelles et vivaces tirent leur révérence à la belle saison, la magnificence s’est décalée vers le jardin d’eau.
Lui d’habitude si paisible et serein sort de sa méditation.
L’automne, ce peintre fauve, y fait voltiger ses invisibles pinceaux, et chaque jour le tableau change, toujours plus flamboyant.
C’est le moment où il faut voir le bassin, dans la lumière de midi, quand il tend des reflets de bleu pur qui se mêlent à l’or des frondaisons.
Autour des derniers boutons de nymphéas, qui ne s’ouvriront plus, leurs feuilles vertes et mauves éclaboussées d’ambre offrent des mondes en réduction.
Miroir parfait dans l’air immobile, la surface est le terrain de jeu préféré de la brise, qui vient la chatouiller de temps en temps. Dans le flou des éclats de lumière qui s’emmêlent, on entendrait presque ses éclats de rire.
Les jardins d’Angélique
 Pour ceux qui ont envie de prolonger la visite de Giverny par celle d’autres jardins, plusieurs endroits enchanteurs les attendent en direction de Rouen : le jardin plume, le parc du château de Vandrimare, et les jardins d’Angélique sont tous trois situés dans le même secteur en pleine campagne, à quelques kilomètres de la capitale normande.
Pour ceux qui ont envie de prolonger la visite de Giverny par celle d’autres jardins, plusieurs endroits enchanteurs les attendent en direction de Rouen : le jardin plume, le parc du château de Vandrimare, et les jardins d’Angélique sont tous trois situés dans le même secteur en pleine campagne, à quelques kilomètres de la capitale normande.
Vandrimare est un jardin puissant, tout en arbres majestueux. Plume, un endroit sensuel et tactile, où la vue invite au toucher. Les jardins d’Angélique sont un rêve de jardin, un paradis doux et poétique à la touche très féminine.
Angélique était la fille des propriétaires. Elle a rejoint les anges, mais son souvenir flotte partout au coin des massifs : harmonies tendres blanches ou de tons pastels, statuettes d’angelots disposées deci-delà, délicat mobilier…
Le jardin a été créé par les parents pour tromper leur deuil, travailler le vivant. Ce sont aujourd’hui la mère et la soeur d’Angélique qui l’entretiennent avec une énergie et un goût admirables.
Il faut sans doute voir ces jardins à la saison des roses, partout présentes. En ce début d’automne, un air de mélancolie les gagne, qui leur va bien.
Au centre de la propriété, un manoir du 17e siècle est précédé d’une vaste pelouse. Derrière la bâtisse, on découvre un jardin de buis taillés entourant des carrés de vivaces. Une grande fontaine affirme le classicisme du lieu.
Devant le manoir, on entre dans la partie la plus magique, des ruelles de gazon donnant sur des massifs de fleurs aux accords subtils. Madame Le Bellegard est là, occupée à jardiner mais disponible, prête à renseigner. Encore plus qu’ailleurs chez d’autres passionnés, on sent que son jardin est l’objet de sa tendre attention.
On prend le temps de flâner pour découvrir toute la finesse de ses compositions, la rareté de certains spécimens, les surprises ménagées ça et là. Rien de plus simple : on n’a pas envie de partir…
Jardins d’Angélique Hameau du Pigrard 76520 Montmain (10km à l’est de Rouen)
02 35 79 08 12, ouverts toute l’année de 10h00 à 19h00.
Du 1er juillet au 15 octobre, fermés le mardi.
Entrée 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Les mises en scène de la visite guidée
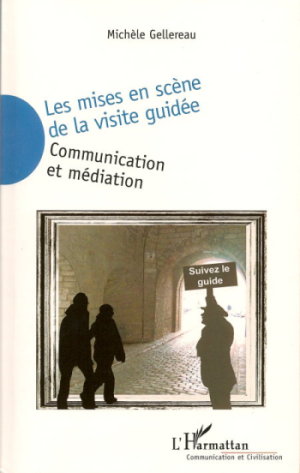 La visite guidée, objet d’études par des chercheurs en communication ? En 2005, Michèle Gellereau, maître de conférences à l’université de Lille, a publié un essai aux éditions l’Harmattan, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation. Grâce à une enquête de terrain qui l’a amenée à suivre une centaine de visites guidées, elle s’est attachée à dégager les points communs des pratiques de guidage, considérées sous l’angle de la communication.
La visite guidée, objet d’études par des chercheurs en communication ? En 2005, Michèle Gellereau, maître de conférences à l’université de Lille, a publié un essai aux éditions l’Harmattan, Les mises en scène de la visite guidée, communication et médiation. Grâce à une enquête de terrain qui l’a amenée à suivre une centaine de visites guidées, elle s’est attachée à dégager les points communs des pratiques de guidage, considérées sous l’angle de la communication.
Michèle Gellereau n’a pas rédigé son ouvrage pour les acteurs concernés, guides ou public, mais pour ses pairs chercheurs en communication. C’est dire qu’il faut un peu s’accrocher pour s’approprier aussi bien le vocabulaire (pourquoi la « scène » de la visite et non le « cadre » ?) que les concepts.
Quelques titres de chapitres au hasard, dans la 2e partie :
De l’interprétation à l’appropriation : la triple mimèsis
Pré-compréhension, configuration et reconfiguration
La capture du temps
Du préconstruit à l’horizon d’attente : deux exemples
On est à mille lieues de notre métier qui consiste tout au contraire à rendre les choses accessibles.
Malgré tout, et sans prétendre avoir tout assimilé, c’est une lecture intéressante pour qui est concerné par le travail de guide. Michèle Gellereau met le doigt sur nombre de nos préoccupations, et formule tout haut des questions essentielles qu’on oublierait presque de se poser. Quel est l’objectif stratégique de la visite guidée ? Quelle est la fonction du guide ? Quelles sont les attentes du public ? Comment donner du sens ? Quelle doit être la place du dialogue dans la visite ?
Chaque guide se fait implicitement une certaine idée de ces questions, et adapte son discours en conséquence.
On ne trouvera pas dans le livre de Michèle Gellereau de réponse définitive, davantage un recensement de différents cas de figures puisés dans des contextes très divers. C’est un point de départ pour s’interroger sur sa propre pratique.
Aux collègues qui me font l’amitié de me lire : je vous prêterai avec plaisir ce livre s’il vous intéresse.
Iris remontant
 Un iris en octobre, au milieu des asters et des cosmos, c’est le spectacle insolite offert par les iris remontants.
Un iris en octobre, au milieu des asters et des cosmos, c’est le spectacle insolite offert par les iris remontants.
Quand on aime les iris, difficile de résister à l’envie de les voir fleurir une deuxième fois. Les catalogues spécialisés en proposent de nombreuses variétés aux noms évocateurs : autumn echo, double click, Halloween Halo…
Tous se hâtent d’ajouter que la deuxième floraison est aléatoire. Elle dépend de la latitude, de l’ensoleillement, de la richesse du sol, de l’arrosage estival, et bien entendu de l’âge du jardinier.
A Giverny, cet iris remontant est le seul que j’aie aperçu dans les jardins, non loin de la serre.
Je ne manque pas de le montrer aux visiteurs, et, cocorico ! si les noms de variétés sont souvent anglais, impératif commercial oblige, le mot technique de « remontant », lui, est passé tel quel en anglais et en allemand.
Toutefois, les anglophones préfèrent dire simplement rebloomer ou reblooming, qui a l’avantage de la clarté.
Les vignes du Seigneur
 Cette abbaye romane qui se dresse derrière des rangées de ceps de vigne n’a pas été photographiée en Bourgogne, mais bien en Normandie. Elle se trouve à quelques kilomètres de Rouen dans l’une des boucles de la Seine qui serpente paresseusement jusqu’à la mer, ponctuée d’abbayes le long de son parcours. C’est l’abbaye Saint-Georges de Boscherville.
Cette abbaye romane qui se dresse derrière des rangées de ceps de vigne n’a pas été photographiée en Bourgogne, mais bien en Normandie. Elle se trouve à quelques kilomètres de Rouen dans l’une des boucles de la Seine qui serpente paresseusement jusqu’à la mer, ponctuée d’abbayes le long de son parcours. C’est l’abbaye Saint-Georges de Boscherville.
Il n’y a plus de communauté religieuse en activité ici. Pour cela, il faut aller à Saint-Wandrille ou au Bec-Hellouin. Mais une association très active restaure et entretient les lieux. Les jardins de l’abbaye, en particulier, ont été entièrement recréés, y compris les vignes, qui fournissaient autrefois le vin de messe.
On dit pis que pendre du vin du val de Seine. Non loin de là, à Jumièges, celui de Conihout faisait l’objet de ce distique définitif :
De Conihout ne buvez pas,
car il mène l’homme au trépas.
Le vin de Vernon, Giverny ou Saint-Marcel, nommé le cailloutin, n’était guère meilleur. On dit qu’il fallait trois mains pour boire le vin normand : une pour tenir le verre, et deux pour s’accrocher fermement à la table pour ne pas s’écrouler.
Tout cela, c’est du passé ! J’ai goûté cette semaine un raisin incroyable à Boscherville.
En me voyant prendre la photo, le viticulteur qui peaufinait l’entretien du clos avant la vendange m’en a proposé une grappe : surprise, les grains étaient gorgés de sucre et de saveur.
Le muscat de Hambourg est réputé pour fructifier très au nord. Le vigneron m’a assuré qu’il demande peu de traitement, juste un peu de bouillie bordelaise. Peut-être que le vin qu’on en tirerait ne serait pas exceptionnel, mais comme raisin de table, cueilli à point, il surpasse celui qui nous arrive du sud au terme d’un long voyage.
Coucher de soleil à Giverny
 Autant les levers de soleil sont somptueux à Giverny, autant les crépuscules font dans la retenue, du moins en ce moment proche de l’équinoxe où le soleil se couche vraiment à l’ouest.
Autant les levers de soleil sont somptueux à Giverny, autant les crépuscules font dans la retenue, du moins en ce moment proche de l’équinoxe où le soleil se couche vraiment à l’ouest.
C’était une lubie, un rêve, un fantasme, voir le soleil descendre de plus en plus orange à l’horizon, et se refléter en éclats d’or entre les nymphéas, comme sur les tableaux de Monet.
Pour confronter la réalité avec cette vision imaginaire, la semaine dernière je suis restée un peu tard dans les jardins de Giverny.
Et tandis que je patientais en attendant la tombée du jour, il devenait de plus en plus évident que le soleil piquait tout droit… derrière le massif de bambous plantés on ne sait pourquoi pile dans l’axe par Monet.
Un peu de poussière dorée sous le pont japonais, des feuillages plus gris que verts, voilà tout le spectacle offert par l’astre du jour sur le déclin.
Il faudra que je revienne à une autre période de l’année, quand le soleil finit sa course plus au nord ou plus au sud, et que le crépuscule magnifie le ciel à gauche ou à droite de la bambouseraie.
Interlude

Si vous avez connu la télé noir et blanc, vous vous souvenez peut-être du petit train d’interlude qui faisait patienter les spectateurs avec des rébus ou de petites histoires, qui défilaient à un rythme d’une lenteur inimaginable aujourd’hui.
Les feuilles d’automne à la queue leu leu au milieu des nénuphars m’ont fait penser à vous proposer cet interlude dans la visite de la maison de Monet.
Nous irons bientôt nous promener à l’étage et dans la salle-à-manger et la cuisine.
En attendant, un petit coup d’oeil sur le jardin que l’automne poétise.
Premier atelier
 Dans la maison de Monet, la petite entrée, réservée à l’usage du peintre, mène d’un côté à l’escalier vers sa chambre, de l’autre à son premier atelier. Celui-ci se trouve en contrebas du reste de la maison. Si l’on vient du jardin, il faut donc monter quelques marches juqu’au perron pour ensuite les redescendre, ce qui ne semble pas très logique.
Dans la maison de Monet, la petite entrée, réservée à l’usage du peintre, mène d’un côté à l’escalier vers sa chambre, de l’autre à son premier atelier. Celui-ci se trouve en contrebas du reste de la maison. Si l’on vient du jardin, il faut donc monter quelques marches juqu’au perron pour ensuite les redescendre, ce qui ne semble pas très logique.
La disposition un peu bizarre des lieux s’explique par leur affectation d’origine. Quand il s’installe à Giverny, Monet trouve une grange sur le côté gauche de la maison. De cette vaste pièce au sol en terre battue, il va faire son premier atelier, en ajoutant un plancher, des boiseries et une volée de marches pour le relier au reste de la maison. Conformément au goût de l’époque, ces éléments sont réalisés en pitchpin.
Du haut de l’escalier, le regard embrasse l’atelier où rien ne semble avoir changé, du mobilier aux bibelots, des lampes au bouquet de plumes de paon.
Sur le côté, on remarque à peine une grande porte cochère, la porte d’origine de la grange, de plain-pied avec le jardin. Le peintre pouvait aussi passer par là pour entrer ou sortir avec ses invités.
L’épicerie
 Dans la maison de Monet à Giverny, une petite épicerie fait suite au salon bleu. C’est une pièce qui fait office d’office, si j’ose dire, pas vraiment un office officiel, plutôt une entrée transformée en épicerie. Ceci explique sa place pas du tout conventionnelle ni pratique, entre salon et atelier. On s’attendrait plutôt à la trouver près de la cuisine, ou à la limite à proximité de la salle-à-manger.
Dans la maison de Monet à Giverny, une petite épicerie fait suite au salon bleu. C’est une pièce qui fait office d’office, si j’ose dire, pas vraiment un office officiel, plutôt une entrée transformée en épicerie. Ceci explique sa place pas du tout conventionnelle ni pratique, entre salon et atelier. On s’attendrait plutôt à la trouver près de la cuisine, ou à la limite à proximité de la salle-à-manger.
Les couleurs des murs, vert pâle et mauve, ne frappent pas dans ce local, et les jolis meubles ont échappé à la fièvre coloriante qui prévaut ailleurs. Le buffet façon bambou a gardé sa couleur naturelle, de même que les boîtes à oeufs et le vestiaire, en vrai bambou cette fois.
Le salon bleu se traversait en diagonale. L’épicerie, quant à elle, distribue quatre ouvertures, si bien qu’il y avait à l’époque de Monet de multiples façons d’y passer en allant au jardin ou en en revenant. Elle pouvait aussi être plus qu’un corridor, le but d’un trajet depuis le salon pour y chercher ou y déposer quelque chose.
Le charme de cette petite pièce, une de mes préférées dans la maison, tient beaucoup à sa simplicité, sa décoration un peu désuète qui n’en fait pas trop. Surtout, les boîtes à oeufs lui donnent un esprit campagne qui sied bien à la demeure.
Le salon bleu
 A gauche de l’entrée de la maison de Monet s’ouvre le salon bleu. Autrefois, c’était un séjour. Aujourd’hui, les visiteurs traversent rapidement la pièce, comme s’il s’agissait d’une antichambre.
A gauche de l’entrée de la maison de Monet s’ouvre le salon bleu. Autrefois, c’était un séjour. Aujourd’hui, les visiteurs traversent rapidement la pièce, comme s’il s’agissait d’une antichambre.
On est frappé, dans les maisons bourgeoises du 19e siècle, par la petitesse des volumes. Impossible d’imaginer recevoir dans ce salon. Mais à la campagne, on recevait autour de la table, dans la salle-à-manger.
A part le sol fait de carreaux de ciment dans le goût de l’époque, tout est bleu dans la pièce. Monet avait fait peindre les meubles, les murs et le plafond en bleu pâle. Son mot d’ordre : de la couleur partout, à saturation, presque à l’excès. Des couleurs claires et gaies.
Peints ton sur ton, les meubles se fondent dans les murs. La bibliothèque, un buffet cauchois dans lequel trônent les livres de jardinage, et l’horloge ont l’air de faire partie d’un tout uniforme.
Les deux bleus durs font ressortir le bleu doux des estampes japonaises, dont la collection se poursuit d’une pièce à l’autre à travers une grande partie de la maison.
Par la fenêtre étroite entre un jour parcimonieux. Après le bain de lumière du jardin, il fait sombre dans ce salon ombré par les ifs.
Assailli par toutes ces perceptions visuelles insolites, le visiteur tente d’imaginer la vie de famille dans ce petit salon. Cette fois l’image paraît plus conventionnelle. Alice assise sur le canapé, peut-être en train de coudre ou de lire, avec ses enfants en train de jouer à côté…
Les petites photos disposées ça et là dans le salon ne nous dévoileront rien sur l’usage qui pouvait être fait de cette pièce. Elles racontent des scènes qui se jouent ailleurs, Michel sur un véhicule à moteur qu’on n’ose appeler une automobile, Jacques posant dans son garage, la petite-fille d’Alice avec une poupée… Chacune d’elle apporte davantage de questions que de réponses.

Les oies dans le ruisseau
12 octobre 2011 / 5 commentaires sur Les oies dans le ruisseau
Une des oeuvres de Monet les plus fascinantes que le Musée des Impressionnistes Giverny présente jusqu’au 31 octobre 2011 s’intitule les Oies dans le ruisseau. Comme toutes les toiles de l’exposition, elle vient du Francine and Sterling Clark Art Institute de Williamstown, aux États-Unis. Le couple de collectionneurs l’a acquise en 1949, manifestant une fois de plus la sûreté de son goût.
Le tableau est signé et daté en bas à gauche : Claude Monet 74. 1874, c’est l’année de la première exposition impressionniste chez Nadar, éreintée par les journaux, l’année où le public découvre Impression, soleil levant et où le mot impressionnistes est forgé par dérision par un critique.
Les oies dans le ruisseau, ce titre, chez Monet, sent le paradoxe. Derrière un sujet champêtre conventionnel, dénué d’originalité au premier abord, il y a dans ce tableau toute l’audace et la fougue d’un Monet de 33 ans qui semble habité par ses recherches picturales.
Pour une fois, le peintre a choisi le format vertical, celui des portraits, pour un paysage. Ce cadrage renforce l’effet de profondeur, accentue l’étroitesse du passage qui conduit vers la maison à l’arrière-plan.
Cet axe bien posé, Monet va s’employer à brouiller les cartes.
C’est une journée ensoleillée, assez chaude pour qu’on laisse les portes ouvertes, mais l’automne a déjà l’air de teinter les arbres de droite et de déplumer ceux de gauche.
L’air est vibrant d’une belle lumière que Monet capte en coups de brosse rapides, pâteux. Les tonalités de verts et de roux rehaussés de bleu marine se répandent sur les feuillages, dans l’eau et le chemin, en petits points lumineux qui noient les contours.
Les oies ont décidé de se jeter à l’eau, formant des rides à la surface qui attirent le regard comme une cible. Mais à peine l’oeil se pose-t-il sur les formes blanches des volatiles, qu’il nage en pleine confusion au milieu des oiseaux et de leurs reflets fragmentés en petites touches claires.
Le regard poursuit son enquête, cherche la berge. Où est-elle ? Où commence et où finit le ruisseau ? Impossible de le savoir avec certitude, car Monet a très habilement fait s’étirer les ombres des arbres de gauche dans la continuité des cercles sur l’eau. Le chemin a l’air de continuer la rivière, sans délimitation définie ni de ligne ni de couleurs.
Si le regard s’avance dans cette partie ombragée, attiré par les teintes contrastantes de la maison, il vient buter sur l’énigme de la porte ouverte, en plein dans l’axe de la perspective. Où se trouve le fond du tableau ? Il se dérobe, petite zone sombre qui ne donne rien à voir. On nous propose d’entrer, sans nous y inviter vraiment.
Le tableau n’a pas d’horizon. Les volumes se fondent les uns dans les autres, se confondent. Ou alors ils se masquent, comme les arbres qui cachent la maison. Rien n’est montré en entier, les oies elles-mêmes sont toutes petites dans le tableau, esquissées plutôt que dépeintes.
Qu’on ait envie de jouer avec Monet au jeu des frontières ou non, les teintes chaudes et l’équilibre du tableau séduisent. Il y a juste ce qu’il faut d’orange dans le toit pour répondre au bleu du ciel, juste assez de masse solide pour contrebalancer l’omniprésence du feuillage.
Les éléments privilégiés de Monet sont là, ceux qui exploseront bien plus tard dans le cycle des Nymphéas. L’eau et les reflets, l’importance de l’effet de lumière, la berge plantée d’arbres. Et comme dans le jardin de Monet à l’automne, on retrouve le désir que les végétaux vous englobent pour qu’il n’y ait plus de limite, non plus, entre l’être humain et la nature.