MOOC impressionniste
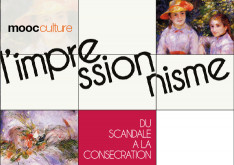 Il reste jusqu’au 14 décembre pour profiter du cours gratuit en ligne sur l’impressionnisme proposé par la Réunion des Musées Nationaux et Orange, en même temps que se déroule l’exposition sur le marchand d’art Paul Durand-Ruel au musée du Luxembourg.
Il reste jusqu’au 14 décembre pour profiter du cours gratuit en ligne sur l’impressionnisme proposé par la Réunion des Musées Nationaux et Orange, en même temps que se déroule l’exposition sur le marchand d’art Paul Durand-Ruel au musée du Luxembourg.
Si comme moi c’est la première fois que vous participez à un MOOC, l’expérience vaut aussi bien pour ce que l’on apprend sur l’histoire de l’art que sur l’utilisation des nouvelles technologies. De quoi s’agit-il ? Un Massive Open Online Course a pour objectif d’enseigner à distance en utilisant les ressources du web. Des vidéos, des textes, des images, des sites permettent d’explorer et d’apprendre depuis chez soi. On échange avec les autres participants, 12 000 à ce jour, comme dans les réseaux sociaux ou les forums. On peut créer des exposés virtuels ou des oeuvres et les montrer aux autres participants.
Le site solerni annonce deux heures par séquence (il y en a huit) et c’est vraiment le minimum pour passer en revue les vidéos proposées. Elles sont toutes intéressantes, et certaines ressources sont de vraies merveilles. Si on souhaite produire quelque chose, ce qui n’est pas obligatoire, ce temps explose. Mais chacun fait comme il veut car il n’y a pas d’autre objectif que le plaisir d’apprendre.
L’inscription au MOOC est gratuite, mais le temps est limité. Le 14 décembre, le site fermera. Vite vite ! Il est encore temps ! Bonne découverte !
A vol d’oiseau
Vus de la colline, la Fondation Monet et son jardin se détachent par leurs couleurs.
On reconnaît vite le rose de la maison et sa forme si particulière tout en longueur.
Dans le jardin, le jaune du ginkgo biloba rayonne près du troisième atelier.
On repère aussi la touche marron des érables du Japon, et l’orange du cerisier fleurs.
Encore un dernier souffle, et ce sera l’hiver.
Plus loin, derrière les peupliers couverts de gui, se dessine l’éventail du parking de la Prairie, puis la plaine des Ajoux et son captage caché par un rempart d’arbres, enfin, tout au fond, les arbres qui bordent la Seine et l’île aux Orties.
Oeil-de-boeuf

Avez-vous deviné d’où cette photo est prise ?
C’est la vue qu’offre l’oeil-de-boeuf situé sur le fronton de la maison de Monet.
J’aime bien les oeils-de-boeuf, même si ça sonne un peu bizarre. Les yeux-de-boeufs, comme j’ai entendu une archi le dire, est plus joli, mais c’est pas nous qu’on décide.
Chez Monet, la question du pluriel ne se pose pas. Il n’y a qu’un seul oculus sur la façade, en plein centre et tout en haut, comme un point sur un i. Rappelons-le, ce n’est pas le peintre qui avait adopté cette disposition, puisque la partie centrale de la maison est celle qui était déjà bâtie à son installation à Giverny.
Pour approcher de l’oeil-de-boeuf, il faut se glisser dans un réduit bas de plafond. C’est, à cet étage, le seul endroit d’où l’on aperçoit le jardin, et on ne peut s’empêcher d’évoquer les garçons qui logeaient à ce niveau à l’arrivée de la famille à Giverny. Jean-Pierre, Michel, Jean et Jacques ont sûrement eu beaucoup d’imagination pour tirer parti de la disposition des lieux pour le jeu et la rêverie.
Musée du cinéma Jean Delannoy
 A trente minutes de Giverny par de jolies petites routes, le musée du cinéma a ouvert cette année à Bueil. Pourquoi dans cette bourgade de la vallée d’Eure ? Parce que le réalisateur Jean Delannoy habitait le village voisin de Guainville, où il est mort âgé de 100 ans en 2008. Jean Delannoy a légué ses archives et souvenirs à l’association de ses amis, qui depuis anime le musée. Les récompenses qu’il a reçues sont là, César, Victoires, Bambi, etc, comme des trophées sportifs.
A trente minutes de Giverny par de jolies petites routes, le musée du cinéma a ouvert cette année à Bueil. Pourquoi dans cette bourgade de la vallée d’Eure ? Parce que le réalisateur Jean Delannoy habitait le village voisin de Guainville, où il est mort âgé de 100 ans en 2008. Jean Delannoy a légué ses archives et souvenirs à l’association de ses amis, qui depuis anime le musée. Les récompenses qu’il a reçues sont là, César, Victoires, Bambi, etc, comme des trophées sportifs.
D’autres dons sont venus se greffer autour de celui-ci, avec l’ambition de montrer la variété des métiers du cinéma. Celui de décorateur est illustré par la reconstitution du bureau de Maigret (Delannoy en a tourné deux). La belle porte que vous voyez est tout à fait fausse mais tous les détails y sont, jusqu’aux gonds.
Parmi les pièces rares, une caméra donnée par la Snecma qui servait à filmer les essais des moteurs d’Ariane non pas à 24 images par seconde mais beaucoup plus, pour un maximum de précision ; un projecteur de 1902, dont j’ai actionné la manivelle à la façon d’un orgue de Barbarie ; et puis une dolly qui fait bien rêver, vous savez cette machine mobile où le cameraman peut s’asseoir et faire monter siège et caméra comme dans un manège.
Le musée rouvrira le 2 mai 2015 avec une expo sur les actrices qui ont marqué la carrière de Jean Delannoy. Parmi elles, Michèle Morgan et Gina Lollobrigida. Glamour à souhait…
Comment taire
 Vous êtes plusieurs à me faire remarquer le petit nombre de commentaires sur ce blog, au point que j’en viens à penser que c’est un sujet qui mérite d’être commenté.
Vous êtes plusieurs à me faire remarquer le petit nombre de commentaires sur ce blog, au point que j’en viens à penser que c’est un sujet qui mérite d’être commenté.
D’abord, merci infiniment à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m’écrire un petit mot. Je suis touchée et reconnaissante de votre envie d’entrer en contact avec moi et avec les autres lecteurs, de faire signe.
Je sais ce que vous ressentez, car moi-même je ne commente pas beaucoup, même sur les sites où je passe des heures. C’est si confortable l’anonymat… Ai-je envie de sortir de cette discrétion qui me protège ? Et en fait, qu’ai-je à dire à cette personne ? L’intérêt, le plaisir, le bonheur que j’ai pris à la lire, à admirer ce qu’elle fait ? Je me sens un peu gauche de cette déclaration. Ca avance à quoi ? Et puis, que va-t-il se passer ? C’est l’internet, et l’internet, ça a des réactions qu’on ne contrôle pas, et j’ai un peu peur.
Voilà ce que je ressens, oui, même moi qui suis blogueuse, c’est-à-dire qui suis confiante dans ma capacité à m’exprimer, qui ai l’habitude de l’internet et qui sais la joie que l’on ressent à lire les commentaires positifs. Autant dire que je comprends, partage et excuse votre aquoibonisme.
Pour avoir beaucoup de commentaires, il faut soit avoir choisi un thème polémique et grand public comme, disons, les relations hommes-femmes ou parents-enfants, l’actualité… soit laisser beaucoup de commentaires soi-même, ce qui revient à un échange entre blogueurs. Cette seconde méthode est très sympa, on finit par bien se connaître les uns les autres, mais elle prend du temps.
Il reste, malgré tout, un doute qui pèse comme une ombre, c’est l’hypothèse qu’un certain nombre de commentaires soient avalés par le logiciel de blog. Si le vôtre n’apparaît pas au bout de deux jours, merci de me le signaler par courriel. (mon prénom, arobase, mon village préféré, suivi de .org. Le tout en minuscules). Si votre commentaire ne s’affiche pas tout de suite, c’est normal : en plus du code anti-robot, je filtre les messages. Quand on a beaucoup de lecteurs, on n’a pas forcément beaucoup de commentaires, mais on a toujours beaucoup de spam.
Les lavoirs de Giverny

Autrefois Giverny, village tout en longueur, disposait de cinq lavoirs sur le Ru. Ces petits bâtiments avaient été construits par la municipalité pour donner un minimum de confort aux femmes qui venaient laver le linge dans le ruisseau, le leur ou celui des autres.
Il reste quatre de ces édicules aujourd’hui, dont trois sont bien visibles depuis la route. Le quatrième est plus retiré, le cinquième a disparu.
Celui-ci, qui se trouve en face du moulin des Chennevières, date de 1903.
On découvre tout sur le financement de la construction des lavoirs, et leur aspect quand ils étaient flambant neufs et en activité, sur le site de cartes postales anciennes Giverny autrefois.
Claude Monet, bienfaiteur de la commune, avait fait un don important pour l’assainissement du marais de Giverny. Les intérêts produits par ce capital ont permis de boucler le budget de la construction de trois des lavoirs.
L’ambre de novembre
L’air sent les feuilles, les champignons et les premiers feux de bois.
Dans les jardins de Monet, une lumière atténuée enveloppe l’étang.
Les saules agitent des rameaux jaunes au dessus de l’eau, le hêtre joue des tons d’ocre et de rouille, les bambous paraissent plus dorés que jamais.
Mais rien ne brille. Pas d’éclat, pas de fanfare aux cuivres rutilants.
Le soleil hésite, pudique, à se départir de son voile.
Novembre, entre l’ombre et l’ambre.
Genévrier

Au-dessus du village de Giverny, le genévrier a profité des terrains rendus disponibles par le recul du pâturage pour s’installer un peu partout sur la colline. Plus que la vue imprenable, son agent immobilier a su lui vendre l’exposition dégagée et plein sud qu’il adore. Un vrai petit solarium où ses baies mûrissent lentement, pour atteindre toutes les nuances de bleu.
En fait de baies, ce sont des galbules, un mot improbable inconnu du Larousse qui désigne ses cônes, puisqu’il fait partie des conifères. Le genévrier les a astucieusement camouflés en fruits si jolis qu’ils ont l’air d’inviter les oiseaux à les manger.
Leur goût, vous le connaissez, pour peu que vous ayez déjà dégusté une choucroute, ils ont une saveur un peu forte et âcre qui donne plutôt envie de les pousser sur le bord de l’assiette. N’en faites rien, c’est pour votre bien.
Les genévriers feront-ils souche à Giverny ? Il faudra pour cela que les brebis continuent de brouter régulièrement sur la colline, tout en grignotant au passage les arbrisseaux qui auraient des velléités de s’implanter. Car si des lotissements entiers de prunelliers surgissent de terre comme des champignons, le genévrier, déçu qu’on lui pique son soleil, ne tarde pas à faire ses bagages vers des cieux plus cléments. Gêné, viré.
Bourdon

Tant qu’il fait beau et tant qu’il y a des fleurs, les butineurs butinent. Tant qu’il ne gèle pas, les sauges sagement continuent de fleurir.
J’ai de la tendresse pour ces ouvriers de la dernière heure. J’admire cette synergie entre les insectes et les plantes, cette foi des sauges dans la présence des bourdons et des abeilles pour venir les visiter, même si tard en saison, les féconder et poursuivre le cycle de vie.
Dans le tourisme aussi les clients deviennent rares, mais pour les visiteurs de novembre les guides disponibles ne sont pas si faciles à trouver. Cet après-midi j’avais une visite de Vernon, et la pluie nous a accompagnés tout du long. Comme toujours dans ces cas-là je me suis débattue avec le dilemme de vouloir faire court pour ne pas maintenir les personnes sous la pluie, mais en même temps de ne pas faire trop court car c’est mon rôle de raconter, de commenter et d’expliquer.
Quand le temps n’est pas très coopératif, quelle est la dose exacte de discours nécessaire et suffisante, la durée maximale de la visite avant que les clients ne se mettent à détester leur guide ? Eux aussi font face à un dilemme, entre leur envie de rester au chaud et leur engagement dans le voyage. Ils sont venus voir, découvrir, s’émerveiller et peut-être apprendre, au prix d’un trajet long et éprouvant. Quand il pleut, ces attentes sont plus vite satisfaites…
Je me demande si les insectes connaissent les dilemmes. Je pense que non. Quand il pleut, les bourdons ne sortent pas. Je ne crois pas qu’ils se forcent à faire ce qu’ils n’ont pas vraiment envie de faire. Et à mon avis, ils ne craignent pas le regard des autres, leurs sentiments ni leur opinion, ce qui doit rendre leur vie beaucoup plus simple. Ils n’ont pas eu besoin d’inventer le parapluie.
N’empêche, peut-être bien qu’à eux aussi, la pluie leur donne le bourdon.
Don de l’artiste
 Le cartel ne le précise pas, mais j’en suis presque sûre, les oeuvres qui ornent le souterrain de Giverny sont un don de l’artiste. Pas moins de trois créations numériques de grand format ont été réalisées par Michel Debully, plasticien givernois, à la demande de l’association des Amis de Giverny. La mise en place s’est faite en mars dernier.
Le cartel ne le précise pas, mais j’en suis presque sûre, les oeuvres qui ornent le souterrain de Giverny sont un don de l’artiste. Pas moins de trois créations numériques de grand format ont été réalisées par Michel Debully, plasticien givernois, à la demande de l’association des Amis de Giverny. La mise en place s’est faite en mars dernier.
Egayer ce passage obscur tout en restant dans l’esprit du village était un vrai challenge, en même temps qu’une nécessité. La réalisation évoque un tryptique contemporain.
Au bout de chaque rampe du souterrain, un tableau de Monet réinterprété par pixellisation est un hommage aux séries peintes par Monet tout près de là. D’un côté des peupliers, La Prairie, de l’autre une meule, Le Clos Morin. L’effet optique rappelle celui produit par les tableaux impressionnistes : on voit mieux l’oeuvre de loin. De près, c’est une juxtaposition de touches colorées.
Dans la partie la plus sombre, Michel Debully a voulu faire sentir Le souffle du printemps grâce à une vaste peinture murale aux tons clairs et frais. Sur 14 mètres de long par 1,25 m de haut, des lignes droites colorées rythment les pas des visiteurs.
A Giverny, d’autres artistes ont fait don d’oeuvres importantes à la communauté. Claude Cambour a offert un spectaculaire tableau du Christ en croix à l’église de Giverny, Daniel Goupil le buste de Monet qui se trouve dans la Prairie, Blanche Hoschedé-Monet une toile présentée au musée des impressionnismes…
C’est une longue tradition, partout, parmi les artistes. Vernon a eu la bonne fortune de recevoir des oeuvres de Claude Monet, des MacMonnies ou plus près de nous, d’Olivier Gerval.
Ce n’est pas dans toutes les professions qu’on pratique si généreusement le don. On peut s’interroger sur la récurrence des dons d’artistes. Ils ont sans doute des motivations variées. Pour ma part, j’y vois celle-ci : quand on a reçu, nul ne sait d’où ni par quel miracle, un talent, un don, on se sent un peu débiteur. On a besoin de donner de son oeuvre pour rétablir l’équilibre.
Pendule
Depuis que les visiteurs l’ont déserté, le jardin d’eau de Monet poursuit son rêve intime.
La vie continue de battre à l’insu.
Le vent arrache les feuilles une à une, ça bruisse et ça souffle.
Les frondaisons plient et ploient.
Les bambous s’entrechoquent.
Les étoiles rouges des liquidambars, les lanières dorées des saules, les petites flèches des peupliers dégringolent de leurs cimes et finissent leur course, parfois, à la surface du bassin.
Elles hésitent un instant, comme étonnées d’être là, puis le vent s’en saisit à nouveau et les fait glisser, frêles esquifs, au ras de l’eau.
Il arrive qu’elles tournoient dans une chorégraphie inattendue, en artistiques patineuses.
Elles finissent par s’accrocher quelque part, dans des ports insoupçonnés où elles s’entassent par centaines.
A la limite entre l’air et l’eau, là où les nuages viennent se mirer en rose et gris, les rameaux du saule s’entêtent à dessiner des calligraphies secrètes.
Leur stylet griffe la surface qui aussitôt se referme, effaçant le message au fur et à mesure.
Tel un pendule, la pointe du saule passe et repasse.
Le regard se laisse happer par cette correspondance mystérieuse, questionner par l’indéchiffrable.
Devant cette cible mouvante, on oublie le temps.
Le pendule a gommé la pendule.
Philippe Auguste de Bruno Galland
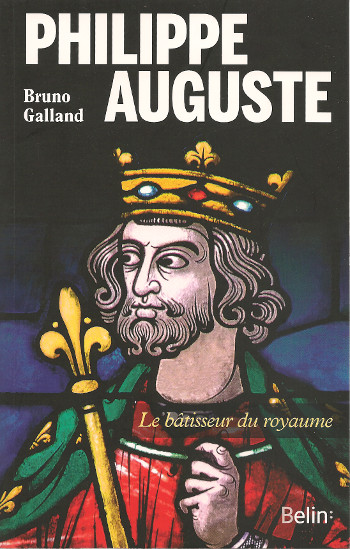 A Vernon, le centre culturel s’appelle l’Espace Philippe Auguste. Il est bâti dans l’enceinte du château de Philippe Auguste, dont il reste de beaux vestiges. C’est là que Bruno Galland est venu, non sans une pointe d’émotion, présenter son ouvrage consacré au fameux monarque.
A Vernon, le centre culturel s’appelle l’Espace Philippe Auguste. Il est bâti dans l’enceinte du château de Philippe Auguste, dont il reste de beaux vestiges. C’est là que Bruno Galland est venu, non sans une pointe d’émotion, présenter son ouvrage consacré au fameux monarque.
La salle était archi-comble, et vraiment cela valait la peine d’assister à cette conférence : Bruno Galland parle avec flamme de son sujet. Son livre, lui aussi, est facile à suivre, écrit dans une langue agréable et claire.
Dans la nébuleuse que constitue pour beaucoup de nos contemporains la succession des rois de France au Moyen Âge, si la figure de saint Louis émerge en premier, celle de Philippe Auguste n’est pas encore complètement oubliée.
C’est par cette phrase (où j’entends une pointe d’autodérision, mais y est-elle vraiment ?) que commence l’ouvrage. Bruno Galland est archiviste-paléographe, ce qui lui permet de travailler directement sur les sources.
Le corpus documentaire dont dispose l’historien qui s’intéresse à Philippe Auguste est exceptionnel. Son règne est le premier pour lequel nous disposions vraiment d’archives centrales : registres de la chancellerie, layettes du Trésor des chartes et même quelques fragments de comptes. S’y ajoute un nombre élevé de chroniques de provenance diverse – les oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, bien sûr, mais aussi les chroniques anglaises de Benoît de Peterborough, Roger de Hoveden, Gervais de Canterbury et Roger de Wendover, la chronique flamande de Gilbert de Mons et l’Histoire des ducs de Normandie commandée par Robert de Béthune, et les chroniques bourguignonnes de Robert d’Auxerre et d’Albéric de Trois-Fontaines…
Grâce à toutes ces informations de première main, le portrait du roi de France que dessine le médiéviste diffère sensiblement de celui que j’ai pu lire ailleurs.
Au physique, Philippe Auguste était, selon les chroniqueurs, « très beau » et non point le petit rabougri qu’on oppose volontiers à l’athlétique Richard Coeur de Lion. Au moral, loin d’être le roi avisé dont se souvient la mémoire collective, Philippe Auguste était impulsif, coléreux, excessif et souvent très dur, en particulier pendant la première moitié de son règne. L’âge l’a rendu plus posé, sans toutefois lui faire perdre complètement son tempérament. Mieux conseillé dès lors qu’il s’appuie sur des sages et non plus des nobles, et servi parfois par les circonstances, Philippe Auguste fait montre d’une volonté obsessionnelle d’agrandir son domaine. Et il y parvient, affirmant toujours davantage sa puissance.
Malgré toutes les sources, il reste tout de même des zones très mystérieuses dans l’histoire de Philippe. Les chroniqueurs sont un peu embarrassés pour raconter le sort fait à Ingeburge, la deuxième épouse du roi. (Galland prononce à la française, « ainjeburje ». C’est un prénom danois.) Le roi épouse la jeune fille, et dès le lendemain la répudie. Il n’a jamais voulu dire pourquoi. Il va garder la malheureuse reine captive pendant 19 ans, en dépit des pressions du pape qui place le domaine royal sous interdit. Philippe Auguste était sujet à des effrois extraordinaires, comme lorsque, tombé malade à Saint Jean d’Acre, il a interrompu brutalement sa croisade. Il est bien difficile d’expliquer la cause de ces revirements désavoués par tous.
Choir, puis gésir
L’automne, comme la guerre, conjugue les verbes défectifs. Les feuilles choient. Les feuilles gisent. Elles cherront encore demain, mais il n’y a pas d’avenir à gésir. Quand on gît, c’est pour longtemps. Le temps s’efface. Gésir, c’est mourir un peu.
De même que l’automne escamote les feuilles, la conjugaison escamote une partie des possibles. Des pans entiers des variations du verbe font défaut.
Il manque des personnes, il manque des temps. Est-ce le temps qui va nous manquer cet hiver ? Ou seront-ce les personnes ?
Quand la nuit tombe, quand les températures chutent, la vie se rétracte et rentre sous terre.
Le coeur se serre un peu face à la sourde mélancolie des feuilles mortes.
Il est temps d’allumer la lumière.
Dépouillement
 Les jardiniers de Giverny ont travaillé dur toute la semaine dernière. Ils ont déjà presque fini de dépouiller les massifs du clos normand.
Les jardiniers de Giverny ont travaillé dur toute la semaine dernière. Ils ont déjà presque fini de dépouiller les massifs du clos normand.
Pour eux, dépouiller n’a rien à voir avec les résultats d’un vote. Il s’agit de faire place nette, d’arracher les annuelles et de rabattre les vivaces en enlevant tout ce qui a fleuri, et ce n’est pas une mince affaire.
Dans leurs brouettes s’entassent les verveines, les sauges, les sedums. Les dahlias sont coupés à ras, retirés à la bêche, et placés dans des cagettes. Une étiquette de couleur indique leur variété. Ils seront stockés à l’abri jusqu’en mai.
Aussitôt libérée, la terre est bêchée. On répand les granulés de fertilisant, un compost végétal. Et puis, déjà, on plante. C’est un va-et-vient de fleurs qui arrivent et d’autres qui s’en vont.
Dans la grande allée, les bisannuelles sont déjà en place, et certaines giroflées se mêlent même de fleurir. Les myosotis dessinent leurs couronnes de feuilles arrondies. Dans les espaces libres, les bulbes disséminés par poquets attendent d’être enfouis dans la terre, les plus gros au plus profond. Un bâtonnet de bambou rappellera leur emplacement.
Certains sont monstrueux, gros comme le poing. On devine des beautés à venir, quand le printemps allumera tous ces feux d’artifices. Mais pour que cela marche, il faut d’abord qu’il fasse froid.
Le tigre et l’ours
 Je suis allée voir « La Colère du Tigre » au théâtre Montparnasse à Paris. La pièce signée Philippe Madral met en scène Georges Clemenceau et son grand ami Claude Monet, au soir de leurs vies.
Je suis allée voir « La Colère du Tigre » au théâtre Montparnasse à Paris. La pièce signée Philippe Madral met en scène Georges Clemenceau et son grand ami Claude Monet, au soir de leurs vies.
Quand je suis arrivée, Claude Brasseur, qui incarne Clemenceau, était assis en terrasse à fumer une cigarette. Sa voix magnifique porte la marque de cette tabagie. Michel Aumont, le Monet de la pièce, a le timbre presque trop clair en comparaison.
Ils ont tous deux le même âge, 78 ans. On ne peut qu’être ébloui par leur performance. En ce sens, ils sont fidèles à leurs modèles : Clemenceau et Monet n’ont jamais décroché du boulot non plus.
Pendant la représentation, j’entendais rire autour de moi. Je ne suis pas la bonne personne pour faire une critique de la pièce : ses personnages et son argument me sont trop familiers, les effets de surprise n’agissent pas.
J’ai eu un peu de mal à entrer dans l’illusion théâtrale, ce pacte qui lie l’auteur, les comédiens et leur metteur en scène avec les spectateurs. Accepter l’idée du rôle, qui nous vient de si loin : on dirait qu’on serait le Tigre et l’Ours de Giverny…
Ces êtres de chair et de sang sur la scène, comment pourrais-je les prendre pour Clemenceau et Monet ? Dès les premières phrases, l’auteur prend ses distances avec la réalité historique : il fait dire à Monet des formules qui sont celles de Clemenceau. C’est le Tigre qui taquine son ami en l’apostrophant d’un « Cher vieux crabe », et non l’inverse. Bon. On n’était pas à une lecture de correspondance non plus.
Si la pièce m’a tout de même captivée, c’est par l’interrogation qu’elle suscite pour moi sur le théâtre. Comment peut-on porter à la scène des êtres qui ont vraiment existé, et non pas seulement des « types », comme Monsieur Jourdain est le type du bourgeois pour Molière ? Qu’est-ce qui fait qu’une personne devient un personnage ? Quelle légitimité le théâtre offre-t-il à imaginer ce que nous ne savons pas, à remplir les blancs ?
J’ai été intéressée par le rapport du fictif au plausible. Par les contraintes du théâtre qui imposent qu’il se passe quelque chose, d’où la fameuse « colère », et une amusante bataille à coups de cannes. Au final, si je n’ai pas été emportée par la magie du théâtre comme d’autres fois, et même si l’émotion m’a passablement désertée, cela valait tout de même la peine de faire le déplacement. Pour me confronter à toutes ces questions.
Au-dessus des méandres
 Quand elle arrive au pied de Château-Gaillard, la Seine change brusquement de direction en oubliant sa destination ultime, la mer. Sans doute effrayée par l’imposante forteresse de Richard Coeur de Lion, elle rebrousse chemin, cap au sud-ouest. Ce n’est qu’une fois parvenue à bonne distance qu’elle réalise la gaffe, à force que son GPS lui serine « faites demi-tour dès que possible ». Elle recalcule enfin son itinéraire et repart en direction de Rouen.
Quand elle arrive au pied de Château-Gaillard, la Seine change brusquement de direction en oubliant sa destination ultime, la mer. Sans doute effrayée par l’imposante forteresse de Richard Coeur de Lion, elle rebrousse chemin, cap au sud-ouest. Ce n’est qu’une fois parvenue à bonne distance qu’elle réalise la gaffe, à force que son GPS lui serine « faites demi-tour dès que possible ». Elle recalcule enfin son itinéraire et repart en direction de Rouen.
Ces méandres du fleuve ont creusé des falaises dans la roche tendre, cette craie blanche barrée de lits de silex caractéristique du val de Seine. D’en haut, la vue porte loin, en un gigantesque amphithéâtre, et offre cette impression de se détacher du sol.
Pour voir Château-Gaillard se dessiner à l’arrière-plan, il ne faut pas aller trop loin. Le belvédère du Thuit est idéal. Mais celui de Notre-Dame de Belle-Garde, d’où j’ai pris cette photo, est plus élevé, et ne se gagne que par une petite marche dans les bois.
Une émouvante Vierge à l’Enfant de 1946 s’y dresse, telle un ex-voto de l’après-guerre. La présence de cette statue sur le promontoire donne à la contemplation du paysage quelque chose de particulier, dû peut-être à l’élan mystique de ceux qui l’ont souhaitée et réalisée là.
Comme un Monet

Il reste une dizaine de nymphéas en fleurs sur l’étang de Monet.
Si tard dans la saison, c’est presque un exploit, favorisé par la douceur du dernier week-end.
Dans les reflets dorés des frênes et des noisetiers, leur rose fait une apparition à contre saison.
La brise d’automne vient brouiller la surface pour y tracer des coups de brosse.
Les feuilles de nénuphar, comme des coupelles, recueillent assez d’eau pour que les arbres s’y mirent, mais trop peu pour que le vent y soulève des vaguelettes.
Comme à l’accoutumée, les qualités picturales du bassin frappent les visiteurs.
Si on avait des pinceaux, on se mettrait à peindre.
On se croirait devant un Monet.
Pomologie
 Cette science, je n’en avais jamais entendu parler avant de vivre en Normandie. Ici la pomologie concerne le plus souvent les pommes. On est donc enclin à croire qu’elle se limite à elles et par conséquent tenté d’écrire ‘pommologie’ avec deux m, mais le mot n’en prend qu’un. C’est l’étude des fruits, du latin pomus, le fruit.
Cette science, je n’en avais jamais entendu parler avant de vivre en Normandie. Ici la pomologie concerne le plus souvent les pommes. On est donc enclin à croire qu’elle se limite à elles et par conséquent tenté d’écrire ‘pommologie’ avec deux m, mais le mot n’en prend qu’un. C’est l’étude des fruits, du latin pomus, le fruit.
Une exposition pomologique vient de se tenir à Giverny, dans l’ancienne gare transformée en salle des fêtes. Dans ce lieu qui fut fréquenté par Monet, les fenêtres dessinent des tableaux de ses paysages.
A peine la porte franchie, on est assailli par une puissante odeur de pomme issue de dizaines de variétés mêlées. Cultivées par le verger-conservatoire de Saint-Clair-sur-Epte, des pommes de toutes espèces, couleurs, formes et aspect sont présentées dans des assiettes étiquetées.
Combien y en a-t-il ? Peut-être une centaine de variétés, et cela a déjà de quoi faire tourner la tête, mais ce n’est pourtant qu’un échantillon des quelque 20 000 cultivars que la nature a inventés.
On parcourt les tables, on lit les noms des fruits. C’est tout un voyage. Rien à voir avec l’étal du marché : ici les pommes sont des individus, avec des têtes, des personnalités, une histoire, et non pas des clones interchangeables. Il y a en elles cette complicité de l’humain et de la nature qui date d’avant l’ère des machines et des engrais. Elles ont été nommées comme on nomme un enfant, et non pour mieux se vendre. Pigeon blanc d’hiver, pigeon commun, croquet, reinette parmentier, gros vert, cramoisie de Gascogne, grand Alexandre, glacée d’hiver… Voici l’api étoilé à la si jolie forme pentagonale. Et voici les reinettes, goûteuses et sucrées, mais défense de toucher !
Quelques passionnés s’attachent à conserver les variétés qui ont régalé nos aînés mais qui ont depuis déserté les étals. Outre le fabuleux réservoir de gènes qu’elles représentent, elles ont de multiples qualités, la première étant d’être parfaitement adaptées au terroir. A leur aise dans l’écosystème, elles résistent à tous les temps et toutes les maladies sans traitement. Ce sont les pommes commerciales qui sont les plus fragiles.
Pontederia

Cette belle plante qui pousse les pieds dans l’eau, c’est le pontederia.
Je l’ai photographiée tout près du pont japonais de Monet, en face des bambous, comme vous pouvez le voir en cliquant sur l’image.
Pour me souvenir du nom du pontederia, je pense au pont, et la suite vient toute seule.
A Giverny, cette aquatique prospère en plusieurs points du bassin, notamment près des petites marches de l’embarcadère.
L’été, elle fleurit en épis bleu pâle. Le reste du temps on aime son feuillage décoratif d’un beau vert dense.
Une autre plante aquatique souvent associée à la pontédérie orne la pièce d’eau de Claude Monet : le thalia.
Cette vivace est plus grande que le pontederia.
Ses inflorescences violettes s’élèvent à hauteur des yeux des visiteurs qui se trouvent sur la berge.
Les feuilles, par leur port et leur forme, rappellent le strelitzia.
Mais pas d’oiseau de paradis dans l’éden de Giverny : il ne fait pas assez chaud pour les plantes tropicales.
La maison de Ravel
 Geneviève Bailly, propriétaire de la belle maison de Lyons-la-Forêt dite « maison de Ravel », a eu la bonne idée d’écrire un petit livre sur la vie du compositeur. Elle y décrit les liens qui unissent Maurice Ravel à cette demeure.
Geneviève Bailly, propriétaire de la belle maison de Lyons-la-Forêt dite « maison de Ravel », a eu la bonne idée d’écrire un petit livre sur la vie du compositeur. Elle y décrit les liens qui unissent Maurice Ravel à cette demeure.
La maison elle-même date du 18e siècle, mais elle a été remaniée dans le style balnéaire anglo-normand entre 1910 et 1914 par ses propriétaires de l’époque, les Dreyfus. « Les toitures sont modifiées, des lucarnes percées et ornées d’épis de faîtage en céramique vernissée : hiboux, perroquets, chats… qui feront en 1940 une belle cible pour les soldats allemands. »
En 1914, Ravel, de constitution peu robuste, est réformé. Mais incapable de supporter l’idée de ne pas participer à la guerre, il parvient à être enrôlé en 1915, comme conducteur de camions. Madame Dreyfus devient sa marraine de guerre. Elle est la mère d’un ami de Ravel qu’il fréquente depuis 1911.
En 1916, Ravel a 41 ans quand il perd sa mère. Son chagrin est immense. Malade, il est définitivement réformé en 1917 et se réfugie à Lyons-la-Forêt chez Madame Dreyfus.
Sa chambre est située « au premier étage au-dessus de l’actuelle plaque commémorative ». Il y compose « Le tombeau de Couperin », dans lequel on peut entendre un hommage à ses amis morts à la guerre.
Ravel revient à Lyons-la-Forêt en 1922 et y compose l’orchestration des « Tableaux d’une exposition » de Moussorgski. C’est son dernier séjour. Par la suite la famille Dreyfus va vendre la maison du Frêne.
Geneviève Bailly, « Ravel à Lyons-la-Forêt », éditions Freylin
Alpaga

A Giverny, les alpagas du moulin des Chennevières ont un petit !
Toute la famille reste groupée dans le grand pré, le jeune au milieu des adultes.
Les alpagas (alpacas en anglais, Alpakas en allemand) peuvent avoir un petit par an, au terme d’une gestation de 11 mois.
Elevé pour sa laine très fine et chaude, l’alpaga est aussi un animal de compagnie et d’ornement, comme dans le petit zoo privé de Giverny.
On dirait un gros mouton au long cou, avec des oreilles en forme de lance, tandis que les lamas, les vrais, sont plus grands et ont des oreilles en parenthèses.
Fascine
 La technique des fascines a quelque chose de fascinant, comme on peut s’en rendre compte sur la page du site de l’N7 consacrée à la restauration végétalisée des berges d’un cours d’eau. J’ai été un peu surprise de voir cette école d’ingénieurs de Toulouse s’intéresser à la question, avant de me souvenir que le H d’ENSEEIHT signifie hydraulique.
La technique des fascines a quelque chose de fascinant, comme on peut s’en rendre compte sur la page du site de l’N7 consacrée à la restauration végétalisée des berges d’un cours d’eau. J’ai été un peu surprise de voir cette école d’ingénieurs de Toulouse s’intéresser à la question, avant de me souvenir que le H d’ENSEEIHT signifie hydraulique.
A Giverny, on est beaucoup aux prises avec l’hydraulique, que ce soit du côté du Ru ou du côté du bassin aux nymphéas, dont l’équilibre subtil tourne parfois au casse-tête. Chaque année, une portion des fascines qui retiennent les berges du ruisseau est renouvelée. Ce travail se fait plutôt l’été quand il fait chaud car c’est déjà bien assez pénible comme ça.
Debout dans l’eau courante, les jardiniers changent les pieux et les entrelacs de branches de châtaignier mis en place le long des rives. Derrière, un géotextile empêche la terre de glisser entre les branches. On peut ainsi planter le long de l’eau, et les racines des plantes servent elles-mêmes à contenir la terre.
La tendance d’un cours d’eau, m’a expliqué l’un des jardiniers, est de grignoter les berges qui s’effondrent et viennent combler partiellement le fond. Le ruisseau s’étale et perd en profondeur ainsi qu’en courant.
Pour conserver au Ru de Monet sa taille initiale et la force de son courant, il faut le canaliser. La technique des fascines est esthétique et naturelle, elle n’a même pas l’air (hélas !) de gêner les rats musqués qui nichent dans les berges. Mais les changements du niveau de l’eau accélèrent la dégradation des bois, ceux-ci ne résistent que quelques années seulement.
Les yeux dans le vide
 Ca ressemblait à du rien. Non pas que cela ne ressemblait à rien, c’était même tout le contraire : cela aurait pu être n’importe où. Dans la brume qui finissait par se lever à 11 heures du matin et qui gommait les lointains, le paysage des champs de Giverny près de l’Epte était si vide que j’ai hésité à faire la première photo. Cela valait-il la peine de saisir le rien ?
Ca ressemblait à du rien. Non pas que cela ne ressemblait à rien, c’était même tout le contraire : cela aurait pu être n’importe où. Dans la brume qui finissait par se lever à 11 heures du matin et qui gommait les lointains, le paysage des champs de Giverny près de l’Epte était si vide que j’ai hésité à faire la première photo. Cela valait-il la peine de saisir le rien ?
Le regard cherche un motif où s’accrocher. Quelque chose de joli. Quelque chose d’anthropomorphique, comme un arbre tout seul nous évoque la solitude, ou une rangée de peupliers fait songer à une farandole.
J’ai pensé à Monet, combien il aimait ces heures de brume. La dissolution du motif si fréquente dans ses toiles, sa banalité, son inimportance. Ce qui compte : les valeurs de couleurs, la lumière qui baigne le paysage, l’air qui enveloppe les choses. Tant de toiles de Monet ne donnent rien à voir d’autre que, nous semble-t-il, un morceau de peinture. Le motif n’est qu’un prétexte à peindre.
En plein milieu des champs que Monet a représentés, sur les chemins qu’il a dû parcourir, j’essaie de sentir ce qu’il ressentait. L’air encore doux de l’automne emplit les poumons. Il y a cette qualité de silence particulière à la nature, un silence plein de souffles, de bruissements, d’appels émis par des êtres dont nous ne comprenons pas la langue, et le ronronnement de la route au loin. Je tends l’oreille, et le silence se peuple de sons.
J’admire l’audace de Monet à se lancer dans le vide. Monet donne à voir le presque rien, et bien entendu, il y voit quelque chose. C’est mon regard habitué à ce paysage qui le trouve vide. Ailleurs, bien loin, là où l’homme s’acharne à cultiver des lopins dans les pentes les plus folles, cette terre à blé fraîchement labourée, riche et plate, donnerait sans doute à rêver…
Le Festival de Giverny
 A Giverny, terre de peinture, on aime la musique. Le week-end dernier avait lieu le Festival de Giverny, une série de concerts autour de la chanson française. Le week-end prochain se tient au même endroit le festival Rock in the Barn, qui programme des groupes de musiques actuelles.
A Giverny, terre de peinture, on aime la musique. Le week-end dernier avait lieu le Festival de Giverny, une série de concerts autour de la chanson française. Le week-end prochain se tient au même endroit le festival Rock in the Barn, qui programme des groupes de musiques actuelles.
L’endroit en question, c’est une ferme au bord de la Seine, tout au bout d’un chemin de terre à travers les cultures. On passe un pont sur un bras du fleuve et on se retrouve dans Grande Ile. Au loin, le chapiteau rouge brille comme une promesse.
La ferme de Grande Ile est désaffectée depuis des années. Le bâtiment le plus grand, la grange, abrite maintenant une scène et des gradins, pour des spectacles intimistes. Tout autour de la grange, la buvette et le resto de plein air donnent au lieu un air de guinguette.
Le Festival de Giverny en est à sa 16e édition, et repose sur le talent de programmateur et l’entregent d’un habitant de Giverny : Eric Carrière, entouré d’une solide bande de bénévoles. Le succès de l’évènement doit beaucoup à son flair pour repérer les stars montantes – Yann Tiersen l’année d’Amélie Poulain, Vincent Delerm à son premier album – et faire venir des pointures, comme l’ex Supertramp John Helliwell. On y croise les artistes qui habitent le coin, tels que Yolande Moreau, Lény Escudéro ou Florent Vintrignier.
Ce dernier était là dimanche, avec la Rue Kétanou. Quand le groupe a commencé, cela faisait déjà plusieurs heures que le public était debout. Au chaud et au sec, les pieds dans la paille, confort rustique du festival normand ou l’on ne s’amuse pas à parier qu’il va faire beau.
Aux premières notes, on aurait dit que quelqu’un venait de monter le thermostat. La Rue Kétanou jouait devant une salle pleine de fans qui connaissaient les paroles des chansons par coeur. On chantait, on tanguait, on battait des mains. C’est pour ces instants de bonheur collectif qu’on vient, et les festivals ont encore de beaux jours devant eux.
Le site des pétasites
 A quoi vous font penser ces feuilles de pétasites ? J’ai entendu des centaines de fois à de la rhubarbe. A des feuilles de nénuphar. A des palettes de peintre. J’ai même entendu à des pizzas, un jour où l’heure du déjeuner approchait. Mais jamais on ne m’avait dit : « Des pétasites ! Tiens ! Nous, on a des péta octets. »
A quoi vous font penser ces feuilles de pétasites ? J’ai entendu des centaines de fois à de la rhubarbe. A des feuilles de nénuphar. A des palettes de peintre. J’ai même entendu à des pizzas, un jour où l’heure du déjeuner approchait. Mais jamais on ne m’avait dit : « Des pétasites ! Tiens ! Nous, on a des péta octets. »
Ce rapprochement inédit était venu à l’esprit d’un spécialiste des réseaux de télécommunications, et une nouvelle fois, j’ai pu m’émerveiller de la diversité des visions du monde propre à chaque visiteur de Giverny.
Un pétaoctet, donc, c’est mille tera. Un million de giga. Un milliard de Mo. Ca commence à faire un peu.
J’étais heureuse d’apprendre l’existence du pétaoctet, donc, qui vaut 10 puissance 15 octets, et dont la racine grecque ne vous aura pas échappé. Et en même temps je me suis demandé dans quelle classe on enseignait ces unités, de nos jours. Au collège ? Au lycée ? Et j’ai pensé que celle-ci devait avoir son petit succès auprès des élèves, dans la veine du grand lac péruviano-bolivien.



